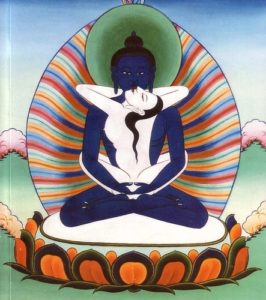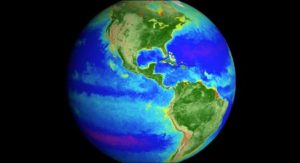Parler du silence

C’est un paradoxe que de parler du silence puisqu’ils sont à première vue mortels ennemis. Dès qu’on parle, on on lui fait violence, on le rompt. Et inversement, le silence se montre parfois l’ennemi de la parole. Il l’interdit, il la censure, il l’écrase. Pourtant, il arrive aussi que l’un et l’autre se mettent en valeur comme dans une danse où tantôt c’est l’un qui guide et tantôt c’est l’autre. Peut-être même existe-t-il un silence que le bruit ne détruit pas. Silence voulu, forcé, silence sacré, la question qu’il pose est autant politique et sociale que personnelle et spirituelle. On le considère comme une absence, un vide à remplir ou à utiliser, ou alors l’objet de la seule quête qui vaille. Beaucoup d’entre nous vivons aujourd’hui tellement saturés de bruits et de paroles que nous aspirons au silence. Mais lequel ? Suffit-il de cesser de parler pour qu’il advienne ? Quel statut donner à la parole ? En réfléchissant à ces questions, je me suis aperçue que c’était assez simple et quasiment dichotomique : il existe deux sortes de silence et de paroles, ceux qui mènent à la vie, et ceux qui portent la mort. Intéressons-nous à ces différences en commençant par ce que nous en dit l’étymologie.
Selon le dictionnaire d’Alain Rey, l’origine du mot silence est incertaine. Son sens dans la Rome antique est clair par contre et plutôt positif. Cela signifie d’abord absence de bruit, et particulièrement de ce bruit articulé qu’est la parole, et deuxièmement repos, calme, inaction. Le silence s’oppose donc pour les anciens autant au bruit qu’au mouvement et il s’applique indifféremment aux humains et aux choses, aux éléments, à tout. Nous aussi, nous en parlons ainsi. Nous aimons le silence immobile du petit matin avant la première trille de  l’oiseau. Et celui de la nuit, celui de l’espace, celui du désert et celui de la haute mer. Silence des cimes et des grottes profondes, rond, calme, sans limite, sans mouvement, qu’aucune parole ne découpe, qu’aucun bruit ne perce. Et puis le bruit ou la parole arrive, éclate dans le silence et c’en est fait de lui. Nous connaissons aussi la réciproque : dans flot des bruits et des paroles, le silence crée la rupture, les sons se taisent avec leur mouvement. Les coachs en communication (comme aussi les profs de théâtre) conseillent d’user du silence pour surprendre et suspendre leur public. En musique, c’est même par le mot de silence qu’on appelle le signe qui marque l’interruption du son. Quand il est plus court, ce silence s’appelle un soupir. Un soupir, un souffle. Le bref silence qui rompt le flux du bruit est une respiration. Et quand il est plus long ? Ce silence en musique s’appelle une pause et nous retrouvons la notion de repos.
l’oiseau. Et celui de la nuit, celui de l’espace, celui du désert et celui de la haute mer. Silence des cimes et des grottes profondes, rond, calme, sans limite, sans mouvement, qu’aucune parole ne découpe, qu’aucun bruit ne perce. Et puis le bruit ou la parole arrive, éclate dans le silence et c’en est fait de lui. Nous connaissons aussi la réciproque : dans flot des bruits et des paroles, le silence crée la rupture, les sons se taisent avec leur mouvement. Les coachs en communication (comme aussi les profs de théâtre) conseillent d’user du silence pour surprendre et suspendre leur public. En musique, c’est même par le mot de silence qu’on appelle le signe qui marque l’interruption du son. Quand il est plus court, ce silence s’appelle un soupir. Un soupir, un souffle. Le bref silence qui rompt le flux du bruit est une respiration. Et quand il est plus long ? Ce silence en musique s’appelle une pause et nous retrouvons la notion de repos.
Seulement pour que le silence soit bienvenu, il faut en être libre. Il faut pouvoir se taire ou bien prendre la parole. Or celle-ci ne nous est pas toujours donnée, ne serait-ce que par la nature. Le silence alors rime avec impossibilité de communiquer. Ainsi, les bébés (c’est même le sens littéral en latin du mot infans, enfant « celui qui n’est pas parlant ») peuvent sortir du silence mais ils doivent se contenter de cris pour sign aler leurs besoins, comme la faim par exemple. Hélas comme il est difficile à beaucoup de comprendre le sens d’un bruit inarticulé, on a pensé jusqu’à une époque très récente que ces cris n’étaient rien d’autre qu’une forme de silence de l’intelligence. Les bébés disait-on, n’étaient que des tubes digestifs dépourvus de sensation et de sentiment. De ce fait, on les laissait crier sans chercher à faire autre chose que de fermer les portes et on les opérait sans anesthésie. Il a fallu attendre les années 70 et les travaux de Françoise Dolto entre autres, pour rendre aux enfants un statut de personne et affirmer que leur incapacité naturelle à organiser les sons ne relevait pas d’une absence de conscience.
aler leurs besoins, comme la faim par exemple. Hélas comme il est difficile à beaucoup de comprendre le sens d’un bruit inarticulé, on a pensé jusqu’à une époque très récente que ces cris n’étaient rien d’autre qu’une forme de silence de l’intelligence. Les bébés disait-on, n’étaient que des tubes digestifs dépourvus de sensation et de sentiment. De ce fait, on les laissait crier sans chercher à faire autre chose que de fermer les portes et on les opérait sans anesthésie. Il a fallu attendre les années 70 et les travaux de Françoise Dolto entre autres, pour rendre aux enfants un statut de personne et affirmer que leur incapacité naturelle à organiser les sons ne relevait pas d’une absence de conscience.
Les sourds-muets sont murés aussi par la nature dans un silence qui dure. Ce fut longtemps un enfermement douloureux que de naître dans cette configuration du destin. On imagine quel sauveteur fut pour eux et leur famille l’abbé de l’Epée qui inventa par compassion il y a trois siècles le langage des signes et ouvrit aux muets le chemin des mots. Je me souviens enfant avoir longé maintes fois leur établissement scolaire qui se trouvait sur le trajet de mon école. Les hurlements inarticulés et disgracieux qui s’élevaient au-dessus des murs à l’assaut des passants m’avaient d’abord franchement inquiétée. Puis un jour j’ai vu sortir par le portail des élèves à l’apparence normale qui se sont arrêtés devant la boulangerie pour échanger des blagues sans un son et acheter des viennoiseries. Leur sauvagerie présumée n’était qu’une fantaisie de mon imagination et  leurs cris était somme toute une variation des cris de ma cour de récréation. Le signe leur rendait une parole silencieuse.
leurs cris était somme toute une variation des cris de ma cour de récréation. Le signe leur rendait une parole silencieuse.
La parole, verbale ou signée, est en effet essentielle à notre vie car c’est un élément constitutif majeur de la communication entre les humains, du moins dans l’état actuel de notre évolution. Elle nous permet l’expression de nos besoins élémentaires, mais aussi de nos besoins affectifs et de nos idées. Physiologiquement, si on ne peut pas dire « Passe-moi le sel », tant qu’on peut se lever, on peut l’attraper. Mais est-il aussi facile en l’absence de vocabulaire d’exprimer ses attentes affectives, de s’interroger sur ses propres raisons d’agir ? De résoudre un conflit ? De développer la pensée abstraite ? L’usage de la parole et un langage évolué sont paraît-il le propre des civilisations raffinées et inversement l’appauvrissement des nuances de la langue traduit celui des locuteurs. Ce silence qu’on pourrait nommer silence par défaut peut faire de nous des frustes ou des taiseux, enfermés un peu comme les sourds-muets dans une situation de handicap verbal faute de disposer d’assez d’outils du langage. C’est pourquoi Charlemagne, mille ans avant Jules Ferry, demanda au clergé d’ouvrir des écoles gratuites pour toute la population, pour que tous aient un minimum de bagage sans que lui-même ait à débourser un denier.
Il existe aussi d’autres silences contraires à l’épanouissement de la vie dont la nature et la culture sont innocentes. Il s’agit du silence social imposé aux faibles par ceux qui sont en position de force. Il y a deux façons de faire. L’une est sans violence apparente, c’est celle du manque d’écoute. L’autre use de violence et crée la servitude.
Le manque d’écoute rend caduque toute parole. Nous l’employons très couramment et quasi inconsciemment. Il s’agit de laisser parler comme on laisse pisser, d’ensevelir ce qu’on entend sous une bonne couche d’indifférence. Pour l’autre, crier dans le désert n’est qu’une variante de se taire dans le désert : le résultat est le même, la parole comme le silence sont impuissance. On le constate à différents étages de la société et cela s’applique à différents âges avec des conséquences de gravité diverse. Souvent les petits enfants sont obligés de crier pour que les adultes consentent à leur répondre. Plus grave mais tout aussi courante su r notre planète, l’indifférence devant les protestations des jeunes filles mariées de force, des personnes âgées placées dans des Ehpad. L’actualité a mis récemment en lumière (et encore ces jours derniers) le cas de plusieurs femmes assassinées par leur mari alors qu’elles avaient trouvé le courage inutile d’aller déposer une plainte ou une main courante. On sait que le procédé est le même au plan national et international. « Je verrai » disait Louis XIV à ses plaignants qu’il n’avait guère écoutés. Aujourd’hui, les peuples et les scientifiques réclament des modifications dans notre politique énergétique par exemple. On leur consent la parole. On ne leur donne pas l’écoute.
r notre planète, l’indifférence devant les protestations des jeunes filles mariées de force, des personnes âgées placées dans des Ehpad. L’actualité a mis récemment en lumière (et encore ces jours derniers) le cas de plusieurs femmes assassinées par leur mari alors qu’elles avaient trouvé le courage inutile d’aller déposer une plainte ou une main courante. On sait que le procédé est le même au plan national et international. « Je verrai » disait Louis XIV à ses plaignants qu’il n’avait guère écoutés. Aujourd’hui, les peuples et les scientifiques réclament des modifications dans notre politique énergétique par exemple. On leur consent la parole. On ne leur donne pas l’écoute.
L’autre silence est obtenu par la répression. Plus le pouvoir est absolu, plus il veut le rester, et plus il muselle. « Qu’ils me haïssent, confiait l’empereur Néron chez Sénèque, pourvu qu’ils me craignent. » Dans ce cas, les plus courageux chuchotent. Cette rétorsion de la liberté de parole n’est pas réservée au politique, elle s’applique dès qu’il y a possibilité pour les forts d’écraser les faibles qui dérangent. On connaît l’omerta, loi du silence de la mafia qui rend si difficiles les enquêtes à son sujet. D’ailleurs un proverbe corse affirme : « Garde le silence et le silence te gardera, » soit en termes plus crûs : si tu parles, tu crèves. Dans le même ordre d’idée, il me revient que quand j’étais petite, ma grand-mère m’avait expliqué une statuette des trois singes qui ne voient, n’entendent et ne disent rien, comme une leçon de survie.

Dans ce cadre, prononcer une parole de protestation pour soi, de soutien à autrui ou de dénonciation est un acte dangereux, et Sénèque que je viens de citer finit donc par recevoir de Néron l’ordre de se suicider, ce qu’il fit. D’une façon générale, ceux qui parlent sont persécutés. Tout le monde connaît Julien Assange. Il n’est pas le seul, les tiroirs d’Avaaz, d’Amnesty international ou de l’ACAT sont remplis des noms de ces malheureux. Le silence consenti est bien plus facile. C’est ce que le pasteur Niemöller a résumé dans une autocritique connue que nous sommes nombreux à pouvoir prononcer. Il y analyse les raisons de sa présence au camp de concentration de Dachau, sous Hitler : « Quand ils sont venus chercher les communistes, dit-il, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les malades, je n’ai rien dit, je n’étais pas malade, quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste. Quand ils  sont venus chercher les juifs, je n’ai pas protesté : je n’étais pas juif… Et puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. » Nos silences faits de lâcheté et d’indifférence à ceux qui sont écrasés participent à la non-assistance à personne en danger, et à terme ils sont lourds de conséquences. On peut les ranger comme le silence des opprimés dans la catégorie du silence de mort. En prendre vraiment conscience nous aidera peut-être à trouver le courage d’une parole défendant la vie.
sont venus chercher les juifs, je n’ai pas protesté : je n’étais pas juif… Et puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. » Nos silences faits de lâcheté et d’indifférence à ceux qui sont écrasés participent à la non-assistance à personne en danger, et à terme ils sont lourds de conséquences. On peut les ranger comme le silence des opprimés dans la catégorie du silence de mort. En prendre vraiment conscience nous aidera peut-être à trouver le courage d’une parole défendant la vie.
Dans la sphère individuelle ou privée, le mécanisme est le même. Entre nous et nous, dans notre for intérieur, nous connaissons des silences que la partie de nous au pouvoir impose au reste de notre être. Actes, évènements ou même pensées qu’on préfère taire à soi-même comme à tous se retrouvent cachés sous le tapis. Nous faisons preuve d’une certaine habileté dans ce coup de balai pour les souvenir pénibles concernant de petites actions honteuses ou ce qu’on nomme pour plaisanter des grands moments de solitude. Nettement plus grave, l’enfant pédophilé ou martyrisé ne doit sa survie qu’à son silence et plus tard, s’il s’en souvient, il continue à se taire, du moins il continuait jusqu’à très récemment. L’explosion récente des metoo et metoo-incest est donc une révolution de la parole par rapport à la pratique millénaire du secret. Elle n’oblitère pas le passé douloureux et silencieux de la victime mais cette dénonciation est une marque de soutien à l’enfant intérieur et un avertissement aux prédateurs. Les horreurs dévoilées et les témoignages amènent aussi la conscience collective à évoluer vers plus d’humanité. Ici aussi, la parole est la vie et le silence son contraire.
D’une façon générale, depuis le siècle dernier, des études dont celles de la psychanalyse ont montré que ce qui n’est pas dit se fait pourtant entendre. Rien ne s’oblitère complètement dans les oubliettes du temps. Ce qui n’est pas reconnu, prononcé ni assumé agit en silence et traverse les générations. « S’ils se taisent, disait déjà le Christ aux pharisiens à propos du peuple qui l’acclamait, les pierres crieront. » Les pierres de la terre mais aussi les corps, les cellules, les mémoires inconscientes, les comportements. C’est un processus global qui ne touche pas que les secrets honteux. Une enquête médicale que je n’ai pas réussi à retrouver avait porté sur les ancêtres de personnes atteintes de maladies des poumons. Une proportion non négligeable de ces patients avaient eu des ancêtres soumis au gaz moutarde en 14-18. Le silence n’est donc pas une solution de guérison puisqu’il n’est silence que des mots, tandis que le malaise qui se dit par le corps, la maladie mentale ou le comportement reste indéchiffré.
déjà le Christ aux pharisiens à propos du peuple qui l’acclamait, les pierres crieront. » Les pierres de la terre mais aussi les corps, les cellules, les mémoires inconscientes, les comportements. C’est un processus global qui ne touche pas que les secrets honteux. Une enquête médicale que je n’ai pas réussi à retrouver avait porté sur les ancêtres de personnes atteintes de maladies des poumons. Une proportion non négligeable de ces patients avaient eu des ancêtres soumis au gaz moutarde en 14-18. Le silence n’est donc pas une solution de guérison puisqu’il n’est silence que des mots, tandis que le malaise qui se dit par le corps, la maladie mentale ou le comportement reste indéchiffré.
Les tragédies grecques ont souvent montré comment le silence du secret, ou celui du mensonge qui est une forme du secret, est le ressort de manipulations et de drames. L’individu privé de sa vérité est dans une cécité dangereuse pour lui, et pas seulement pour lui puisque nous sommes tous interdépendants. Le mythe d’Œdipe en est une illustration majeure. Je ne résiste pas au plaisir de vous le raconter, même si vous le connaissez déjà ! Un jour donc, dans la campagne, un paysan découvrit un nourrisson suspendu à une branche par les pieds. C’était le fils du roi de Thèbes, qui sur la foi d’un oracle s’en était débarrassé préventivement pour éviter que le petit ne l’assassinât plus tard. Le paysan sauva le bébé et l’offrit aux souverains de Corinthe en mal d’enfants, mais le petit Œdipe n’en sut jamais rien. Tel est le secret, triplement gardé par le roi de Thèbes, par le paysan, par les souverains de Corinthe. Lorsqu’il apprit à son tour d’un oracle qu’il allait tuer son père, Œdipe décida de ne plus rentrer à Corinthe, ce qui évidemment ne changeait rien à l’affaire. Mais l’ignorance ne l’obligeait-elle pas à se diriger dans l’obscurité ? A un carrefour de sa route qui se trouva aussi un carrefour de sa vie, il rencontra un chauffard irascible et orgueilleux. Il s’en suivit pour une priorité une altercation qui s’envenima, Œdipe tua le malotru. C’était son père. Ni l’un ni l’autre n’en eurent la moindre conscience. Ce silence opaque sur l’identité de la victime et sur la lignée d’Œdipe l’amena ensuite à devenir roi de Thèbes à la place du roi qui, forcément, ne revenait pas. On lui donna le pouvoir, il épousa la reine sa mère. Mais ni l’un ni l’autre ne connaissait la vérité de l’inceste. Ils eurent quatre enfants dont Œdipe fut le père et le frère, et Jocaste la mère et la grand-mère, jusqu’à ce que soudain les dieux décident de châtier Œdipe à travers son peuple et qu’ils déclarent la peste dans la ville. A la suite d’une douloureuse enquête, le secret fut dévoilé et la vérité se fit jour. Œdipe se creva les yeux maintenant qu’il voyait et il s’exila. Les Thébains cessèrent de mourir par centaines. Le silence causa la tragédie, la parole délia ce qui pouvait l’être. La mère-épouse se pendit et le drame se reporta sur les enfants.
la moindre conscience. Ce silence opaque sur l’identité de la victime et sur la lignée d’Œdipe l’amena ensuite à devenir roi de Thèbes à la place du roi qui, forcément, ne revenait pas. On lui donna le pouvoir, il épousa la reine sa mère. Mais ni l’un ni l’autre ne connaissait la vérité de l’inceste. Ils eurent quatre enfants dont Œdipe fut le père et le frère, et Jocaste la mère et la grand-mère, jusqu’à ce que soudain les dieux décident de châtier Œdipe à travers son peuple et qu’ils déclarent la peste dans la ville. A la suite d’une douloureuse enquête, le secret fut dévoilé et la vérité se fit jour. Œdipe se creva les yeux maintenant qu’il voyait et il s’exila. Les Thébains cessèrent de mourir par centaines. Le silence causa la tragédie, la parole délia ce qui pouvait l’être. La mère-épouse se pendit et le drame se reporta sur les enfants.
La conspiration spontanée du secret a mené la tragédie à son terme, mais c’est l’oracle qui l’avait enclenchée au moyen d’informations incomplètes et de silences partiels. La tragédie d’Œdipe nous alerte sur les conséquences de nos silences et elle illustre pour chacun de nous le poids létal que représente l’ignorance de la vérité. Et aussi, en creux, elle illustre le pouvoir des mots. Dans les Quatre accords toltèques, Don Ruiz place en numéro 1 l’accord suivant : « Que votre parole soit impeccable ». Une parole impeccable est d’abord une parole maîtrisée c’est à dire capable de se retenir comme de se donner. Elle a traversé la peur et l’inconscience. Elle est passée au tamis de Socrate, elle est vraie, bonne, utile pour l’autre et pour nous. Elle ne blesse ni son auteur ni son destinataire. Elle n’est ni mensongère ni faussée. Elle est simple et sincère. Les bouddhistes parlent de parole juste. Au contraire de ce qu’on disait des oracles, cette parole est claire. D’ailleurs l’évangile ordonne en Mathieu 5 : « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu’on y ajoute vient du malin. » Sur quoi abonde le proverbe anglais qui place le diable dans les détails.
 On comprend donc que selon le Dalaï Lama, le bavardage même soit à proscrire. De plus, selon lui, les paroles inutiles détournent l’attention de ce qui est important et focalisent sur le futile. A l’heure des médias et des réseaux sociaux, la parole se démultiplie et se propage et nous sommes probablement devenus plus addicts à la pensée que nos ancêtres. Nous laissons la télé ou la radio allumée même si nous quittons la pièce ou la maison. Parfois nous branchons le réveil avec la radio. Aussitôt, avant même d’avoir ouvert les yeux, notre attention est attirée par des paroles, jingle ou chansons et notre conscience se trouve happée dehors avant d’avoir réintégré dedans. C’est la guerre au silence, extérieur et intérieur, car non seulement nous le détruisons dans notre environnement dès notre réveil, mais nous n’écoutons que d’une oreille, l’autre étant déjà occupée par nos auto-bavardages. Ou alors, elle dort encore.
On comprend donc que selon le Dalaï Lama, le bavardage même soit à proscrire. De plus, selon lui, les paroles inutiles détournent l’attention de ce qui est important et focalisent sur le futile. A l’heure des médias et des réseaux sociaux, la parole se démultiplie et se propage et nous sommes probablement devenus plus addicts à la pensée que nos ancêtres. Nous laissons la télé ou la radio allumée même si nous quittons la pièce ou la maison. Parfois nous branchons le réveil avec la radio. Aussitôt, avant même d’avoir ouvert les yeux, notre attention est attirée par des paroles, jingle ou chansons et notre conscience se trouve happée dehors avant d’avoir réintégré dedans. C’est la guerre au silence, extérieur et intérieur, car non seulement nous le détruisons dans notre environnement dès notre réveil, mais nous n’écoutons que d’une oreille, l’autre étant déjà occupée par nos auto-bavardages. Ou alors, elle dort encore.
Or une parole impeccable appelle une écoute impeccable, une écoute faite pour entendre. Bienveillante et silencieuse, elle n’engage pas seulement la tête mais le cœur si bien qu’elle peut modifier quelque chose chez celui qui écoute. Cette écoute ne double pas le discours de l’autre par les sous-titres de ce que nous en pensons. Elle ne coupe pas la parole pour assener un point de vue personnel. Tranquille et ouverte, elle accueille. Le corps même reste détendu. Elle sait laisser un temps de silence après une phrase. Un coach  capitaine d’armée rencontré sur youtube conseille à ses auditeurs de compter jusqu’à dix avant de répondre à un subordonné, pour être sûr de ne pas interrompre sa pensée. Ce procédé tient compte de deux aspects de notre relation au silence. D’abord, celui qui parle en a besoin car cela lui donne une chance d’aller plus loin et l’espace pour le faire, surtout en situation émotionnelle tendue devant un supérieur (quelle que soit la forme de cette supériorité, affective, hiérarchique ou autre). Et d’autre part, compter diminue notre difficulté à laisser place au silence : le comptage le meuble et le remplit.
capitaine d’armée rencontré sur youtube conseille à ses auditeurs de compter jusqu’à dix avant de répondre à un subordonné, pour être sûr de ne pas interrompre sa pensée. Ce procédé tient compte de deux aspects de notre relation au silence. D’abord, celui qui parle en a besoin car cela lui donne une chance d’aller plus loin et l’espace pour le faire, surtout en situation émotionnelle tendue devant un supérieur (quelle que soit la forme de cette supériorité, affective, hiérarchique ou autre). Et d’autre part, compter diminue notre difficulté à laisser place au silence : le comptage le meuble et le remplit.
C’est que, à force de vivre dans le bruit et les paroles constantes, nous avons peur du silence. Nous vivons loin du cœur dans notre tête, nous la surchargeons de pensées si bien que lorsque nous cherchons le silence, que se passe-t-il ? Nous nous trouvons devant cette évidence : il nous est impossible. Dans notre crâne, ça chantonne, ça bougonne, ça marmonne, ça fait même une sorte de brouhaha indistinct quand il n’y a pas de mots. Nous sommes enfermés dans un univers très restreint, le nôtre : nos souvenirs, nos projections, nos commentaires, nos réactions à l’actualité politique ou familiale, nos limitations, nos conditionnements… sans compter les bribes de pensées décousues qui se superposent un instant avant de s’évanouir et d’être remplacées par un autre magma.
C’est comme une obsession de paroles qui se contamine et se superpose à nos sens. On en a parlé pour l’écoute parasitée par nos propres pensées. Et la vision ? Dès que nous ouvrons les yeux, notre regard est bavard. La pensée s’interpose entre nos yeux et la chose regardée. Nous lui donnons-donc au moins un nom,  et souvent davantage : une fiche entière d’informations égocentrées et notre commentaire d’évaluation avec son nombre d’étoiles… En un mot nous ne savons pas plus voir silencieusement qu’écouter silencieusement. Faisons le tour de nos organes sensoriels, nous nous apercevons que nous les squattons tous. Goûtons-nous une saveur ? Aussitôt elle est jugée, et classée. Idem pour le toucher ou l’odeur. Si nous rencontrions quelque chose d’inconnu, que se passerait-il ? Nous chercherions à mettre des mots dessus, et à l’étiqueter n’est-ce pas ? Nous émettrions un jugement, un raisonnement qui ramènerait cette chose nouvelle dans des catégories anciennes, connues et analysables, au royaume du cerveau gauche, celui de notre égo.
et souvent davantage : une fiche entière d’informations égocentrées et notre commentaire d’évaluation avec son nombre d’étoiles… En un mot nous ne savons pas plus voir silencieusement qu’écouter silencieusement. Faisons le tour de nos organes sensoriels, nous nous apercevons que nous les squattons tous. Goûtons-nous une saveur ? Aussitôt elle est jugée, et classée. Idem pour le toucher ou l’odeur. Si nous rencontrions quelque chose d’inconnu, que se passerait-il ? Nous chercherions à mettre des mots dessus, et à l’étiqueter n’est-ce pas ? Nous émettrions un jugement, un raisonnement qui ramènerait cette chose nouvelle dans des catégories anciennes, connues et analysables, au royaume du cerveau gauche, celui de notre égo.
Dans ces conditions, ce n’est jamais l’autre ou quelque chose de nouveau que nous voyons tel quel, mais toujours une projection de ce que nous sommes. Or qu’est-ce que la projection de nous ? Laissons de côté l’action silencieuse des mémoires inconscientes. Il reste la projection d’un amas de souvenirs d’expériences, de pensées, de croyances et d’émotions qui nous ont fait ce que nous sommes à l’instant de la projection. Je me souviens d’une session de thérapie de constellation familiale qui démontra la chose d’une façon radicale. Le principe de ces constellations est que laissant parler son intuition, on peut participer à une scène relatant un moment d’une vie de quelqu’un en donnant corps à un personnage, sentiment, jugement. Au moment dont je parle, un fils se trouvait dans une violente confrontation avec son père. On fit entrer la colère. Elle se plaça devant le père et s’interposa. Arrêtons-nous ici. Que regardait le fils ? Non plus le père, il était caché par la colère du fils qui ne voyait donc que sa propre projection. Qu’entendait-il ? Rien d’autre que le bruit de sa colère qui couvrait la voix du père.
 Par notre bruit interne, nous sommes du passé qui se prolonge et nous ratons ce qui est là dans le présent. Nous ne voyons jamais qu’à travers les lunettes déformantes de notre mental le présent qu’il a modifié (d’ailleurs, mental et mentir ont la même racine latine). Mais comme cette modification n’est qu’un filtre réservé à notre propre usage et non pas la marque d’un pouvoir qui modifierait véritablement la réalité, nous vivons dans une sorte d’illusion, un monde personnel, chacun le nôtre. De ce fait, nous passons à côté de la vie telle qu’elle s’offre à nous. Nos paroles ne sont donc pas du côté de la vie et nos silences n’existent pas : tout est vampirisé par notre égo. Nous pouvons penser ici au deuxième accord toltèque : « Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle. »
Par notre bruit interne, nous sommes du passé qui se prolonge et nous ratons ce qui est là dans le présent. Nous ne voyons jamais qu’à travers les lunettes déformantes de notre mental le présent qu’il a modifié (d’ailleurs, mental et mentir ont la même racine latine). Mais comme cette modification n’est qu’un filtre réservé à notre propre usage et non pas la marque d’un pouvoir qui modifierait véritablement la réalité, nous vivons dans une sorte d’illusion, un monde personnel, chacun le nôtre. De ce fait, nous passons à côté de la vie telle qu’elle s’offre à nous. Nos paroles ne sont donc pas du côté de la vie et nos silences n’existent pas : tout est vampirisé par notre égo. Nous pouvons penser ici au deuxième accord toltèque : « Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle. »
Bigre ! Quel défi pour nous ! Que se passera-t-il si notre personne est réduite au silence ? Nos pensées et nos croyances ont façonné notre personnalité, nous y sommes identifiés, qu’allons-nous devenir si le silence s’installe ? Mourir peut-être ? Lorsque le Christ a dit qu’il fallait renoncer à soi-même, ces paroles énigmatiques et inquiétantes ont mené à des conclusions que Pascal a résumé en trois mots : Le moi est haïssable. Dangereuse formulation, car qui donc va haïr ce moi, sinon un autre moi qui s’appuiera sur la pensée de ce qu’il aura compris ? L’incompréhension de ce conseil a mené beaucoup de gens au long des siècles dans des vies de privations et de divisions internes où l’égo loin d’être amoindri était dictatorial et simplement plus malheureux. Or justement, le renoncement auquel le Christ nous exhorte est celui de notre égo. Il s’agit de faire taire notre personnalité, pour expérimenter le silence de nos conditionnements, de nos limitations, bref, ce que nous imaginons être nous, et pour découvrir le bonheur de notre vrai moi. Alors comment faire ? Au cas où nous voudrions oser l’expérimentation, partons de notre bon sens. Si ce qui fausse la réalité, c’est ce que nous ajoutons par les mots et les pensées aux informations de nos sens, alors il faut nous appliquer à la soustraction. Il faut gagner le silence.

A ce sujet j’ai entendu Krishnamurti raconter une histoire. La voici. C’est l’histoire du diable qui se promène avec un ami sur la terre. Soudain, il rit et se frotte les mains. – Qu’est-ce qu’il y a ? demande le copain. – Tu vois celui-là ? Celui qui vient de se baisser pour ramasser quelque chose ? Eh bien c’est un morceau de la vérité. – Je ne te comprends pas, dit l’autre, ce n’est pas bon pour nous, ça ! – Attends, attends, répond le diable, je vais l’organiser. Organiser, c’est-à dire ajouter à la perception directe et silencieuse la médiation du mental qui va analyser, disséquer, désosser, limiter et ramener dans les cases du connu. Il n’est pas question de s’interdire de penser, ce qui est bien nécessaire dans de nombreuses situations. D’ailleurs les sages ne conseillent pas de tendre vers un encéphalogramme plat, mais il faut aller vers une tranquillité qui n’a pas besoin de gloser ce qui se présente. Et puis ensuite, il faudrait l’intention et l’audace d’y rester.
Comme dans nos civilisations, ce calme est presque inaccessible, il y faut de l’entraînement. C’est précisément le travail de la méditation. Écoutons encore Krishnamurti dans son livre : La révolution du silence (titre que j’ai trouvé particulièrement juste en ce qui me concerne) : « La méditation est  la totale inaction d’une conscience qui voit ce qui est sans les empêtrements du passé. » Si la personnalité liée à la mémoire s’est effacée, elle a forcément emmené avec elle le personnage qui observait. Que reste-t-il ? Selon le mots de Krishnamurti, « une observation sans observateur. » Cette observation ne calme pas seulement les pensées, car il resterait le brouhaha indistinct de notre agitation, mais le cerveau lui-même. Dans ce silence, ce qu’on appelle la personne (c’est à dire nous, dans l’état actuel de notre conscience) ne s’immisce plus entre nous et le reste comme la colère entre le fils et son père dans la constellation familiale. Elle ne crée plus de division entre nous et le monde. Puis, toute chose étant vue – entendue, goûtée etc, sans jugement et sans auteur, l’unité sous-jacente à tout apparaît, il n’y a plus de séparation entre le sujet et l’objet. Il n’y a que de la conscience de ce qui est, dont nous sommes et qui se trouve en nous.
la totale inaction d’une conscience qui voit ce qui est sans les empêtrements du passé. » Si la personnalité liée à la mémoire s’est effacée, elle a forcément emmené avec elle le personnage qui observait. Que reste-t-il ? Selon le mots de Krishnamurti, « une observation sans observateur. » Cette observation ne calme pas seulement les pensées, car il resterait le brouhaha indistinct de notre agitation, mais le cerveau lui-même. Dans ce silence, ce qu’on appelle la personne (c’est à dire nous, dans l’état actuel de notre conscience) ne s’immisce plus entre nous et le reste comme la colère entre le fils et son père dans la constellation familiale. Elle ne crée plus de division entre nous et le monde. Puis, toute chose étant vue – entendue, goûtée etc, sans jugement et sans auteur, l’unité sous-jacente à tout apparaît, il n’y a plus de séparation entre le sujet et l’objet. Il n’y a que de la conscience de ce qui est, dont nous sommes et qui se trouve en nous.
Ici nous avons une réponse à l’inquiétude de notre égo : si je renonce à moi, que restera-t-il ? Eh bien tout. Tout c’est une autre façon de dire Un. Dans cette nouvelle configuration, les piètres jouissances que nous vivons dans notre mode focalisé dans notre personne ne seront-elles pas dépassées d’une façon que l’égo est hors d’état d’imaginer ? Tant que nous serons identifiés et agrippés à lui comme nous le sommes actuellement, nous n’aurons aucune idée de la réponse. Pour découvrir cette autre dimension de nous, il  faudra nous déprendre de lui, de nos limites et de nos interprétations, ou selon le mot du Christ, y renoncer. Il faudra quitter l’illusion pour contacter ce qui est. Alors nous saurons si nous sommes d’accord avec Krishnamurti : « La méditation est l’éveil de la félicité. »
faudra nous déprendre de lui, de nos limites et de nos interprétations, ou selon le mot du Christ, y renoncer. Il faudra quitter l’illusion pour contacter ce qui est. Alors nous saurons si nous sommes d’accord avec Krishnamurti : « La méditation est l’éveil de la félicité. »
Les bouddhistes ont une voie de méditation qui passe par la conscience et la vision. Une autre méthode universelle de méditation nous est donnée depuis longtemps par le judaïsme, elle tient en deux mots : Shema Israël ! qui signifie : Écoute Israël. Soit en 1) Tais-toi Israël, ou du moins, essaye vraiment. C’est à dire n’oublie pas que tu veux écouter, lâche tes pensées qui te ramènent dans ta propre marinade. Il me vient une comparaison. Si nous avons l’intention d’acheter du pain, en général nous y arrivons, même si nous rencontrons des amis avec qui nous parlons, même si une averse nous oblige à  nous abriter et même si nous marchons dans une crotte de chien, chaque fois nous revenons à notre intention première sans nous juger. De même, dirigeons-nous vers l’écoute même si nous rencontrons des obstacles divers, distractions, pensées ou émotions et ne nous jugeons pas dans nos arrêts. Ensuite, en 2) n’oublions pas la consigne donnée ailleurs : « Va vers toi-même » et revenons au corps chaque fois que nous l’oublions, ne nous quittons pas, puisque c’est là que ça vit. Puisque ce sont les oreilles qui écoutent, posons-nous avec elles et restons-y. Amma d’ailleurs donne exactement le même conseil pour tous les sens : sentir et avoir conscience de nos yeux en même temps que de la chose vue.
nous abriter et même si nous marchons dans une crotte de chien, chaque fois nous revenons à notre intention première sans nous juger. De même, dirigeons-nous vers l’écoute même si nous rencontrons des obstacles divers, distractions, pensées ou émotions et ne nous jugeons pas dans nos arrêts. Ensuite, en 2) n’oublions pas la consigne donnée ailleurs : « Va vers toi-même » et revenons au corps chaque fois que nous l’oublions, ne nous quittons pas, puisque c’est là que ça vit. Puisque ce sont les oreilles qui écoutent, posons-nous avec elles et restons-y. Amma d’ailleurs donne exactement le même conseil pour tous les sens : sentir et avoir conscience de nos yeux en même temps que de la chose vue.
Ensuite se pose la question cruciale : écouter quoi ? Le premier des dix commandements répond clairement à cette question. Il commande d’aimer le Seigneur de tout son cœur de toute son âme et de toute son intelligence. Or Dieu (donnons-lui le nom qui nous convient, Esprit, conscience, vacuité, le Soi, Je suis, la source) donc, Dieu est sans nom et il est interdit de le nommer. De ce fait aimer Dieu signifie aimer le silence. La question devient donc : comment aime-t-on le silence ? Réponse de pur bon sens : en faisant attention à lui, donc en l’écoutant pour entendre. D’ailleurs le principe est général, comment aime-t-on quelqu’un ? En faisant attention à lui, en l’écoutant dans ses paroles et dans ses silences. Le schema Israël nous donne une précision méthodologique essentielle : il faut s’intéresser au silence avec les oreilles et aussi avec le cœur. Et cela change grandement la situation par rapport à la recherche du silence dont nous parlions tout à l’heure. Car si nous cherchons à atteindre le silence avec l’égo dont le propre est de faire du bruit, nous nous plaçons devant une contradiction qui rend la tâche très malaisée. Mais si nous cherchons une rencontre d’amour, nous changeons de plan. Les écrits des mystiques de toutes les religions se rejoignent là-dessus pour en témoigner.
Dans les présentations de son livre Écouter le silence à l’intérieur, Thierry Janssen raconte une courte expérience de ce type qu’il vécut grâce à un marteau-piqueur. Il était en train de travailler et se trouvait en retard sur son emploi du temps. Pour ne rien arranger, des travaux dans la rue en bas de chez lui l’empêchaient de se concentrer. Emporté par une nervosité et une négativité de plus en plus grandes, il se rappela de respirer lentement en ouvrant son cœur pour aimer ce qui se trouvait là. Et alors quelque chose s’ouvrit en lui : un silence au-delà de tout bruit et l’englobant. « Je suis devenu silence, et tout était dedans » dit-il. C’était en quelque sorte une écoute sans écoutant sans séparation entre le sujet et l’objet, lui et le marteau piqueur. Ce silence de vie est d’une autre nature que notre silence ordinaire.
expérience de ce type qu’il vécut grâce à un marteau-piqueur. Il était en train de travailler et se trouvait en retard sur son emploi du temps. Pour ne rien arranger, des travaux dans la rue en bas de chez lui l’empêchaient de se concentrer. Emporté par une nervosité et une négativité de plus en plus grandes, il se rappela de respirer lentement en ouvrant son cœur pour aimer ce qui se trouvait là. Et alors quelque chose s’ouvrit en lui : un silence au-delà de tout bruit et l’englobant. « Je suis devenu silence, et tout était dedans » dit-il. C’était en quelque sorte une écoute sans écoutant sans séparation entre le sujet et l’objet, lui et le marteau piqueur. Ce silence de vie est d’une autre nature que notre silence ordinaire.
Il n’est pas forme, il n’est pas un silence façonné par les ciseaux du son, un silence emprisonné entre deux pensées ou deux mots comme un arbre urbain dans son carré de terre cerné par le béton. Non, il est incréé, il est simplement, comme Dieu se dit « Je suis », quelque bruit qui surgisse au milieu de lui. L’espace n’a ni commencement ni fin, il donne une place dans laquelle se trouvent des objets et que nous enlevions un fauteuil ou en rajoutions un dans notre salon, il n’en est pas affecté, même si le fauteuil est une pure merveille. De la même façon, le silence abrite les sons. Et alors que paroles et pensées ont un commencement et une fin, le silence est l’éternité ou plutôt le non temps. Le temps c’est ça, justement, un commencement qui va vers une fin. Sans temps, que reste-t-il ? Je suis. Que du présent. Dans cette vacuité du silence, ni le mensonge ni l’illusion ne peuvent se glisser, ni aucune des limites du temps ou des objets.
et une fin, le silence est l’éternité ou plutôt le non temps. Le temps c’est ça, justement, un commencement qui va vers une fin. Sans temps, que reste-t-il ? Je suis. Que du présent. Dans cette vacuité du silence, ni le mensonge ni l’illusion ne peuvent se glisser, ni aucune des limites du temps ou des objets.
L’humain qui a rencontré ou pressenti cet infini fait du silence son unique quête. Il sait que l’homme ami du silence vit libre, comme un enfant dans la spontanéité d’un présent que n’atteint aucun commencement ni aucune mort. Cet humain-là cherche entre tous les bruits et même dans tous les bruits et tous les phénomènes le silence sous-jacent. Comme les Indiens se saluent d’un Namasté qui signifie : Je salue Dieu en toi, ou encore je salue l’éternel dans ton éphémère, l’universel dans ta particularité, je salue la perfection dans ton imperfection, ce chercheur dit Namasté, je salue en toi le silence dans ta parole, le silence d’où surgit ta parole.
Quelle peut être alors la parole qui prend exactement et directement naissance dans le silence ? C’est un silence fait son, une parole d’autorité devant laquelle la tempête et la mort s’inclinent parce que sa voix a tout créé. On peut rapprocher cela du big bang, ou en français ce « grand boum » qui a surgi du silence. Dans la Genèse d’ailleurs tout commence par une parole : « Dieu dit. » Jean au début de son évangile développe ainsi : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Il ajoute : « Dieu a fait toutes choses par lui. » Or si on admet que tout, nous, les mondes et les univers, tout est un sans qu’il y ait de temps, ce silence et cette puissance du verbe sont les mêmes aujourd’hui et au commencement. Les implications de cette évidence sont colossales et merveilleuses pour notre monde déchiré. Nous avons vu que notre parole et notre silence habituels peuvent déjà être puissants, alors qu’ils sont passagers. S’ils appartiennent à ce qui demeure, quels seront leur pouvoir ?
rapprocher cela du big bang, ou en français ce « grand boum » qui a surgi du silence. Dans la Genèse d’ailleurs tout commence par une parole : « Dieu dit. » Jean au début de son évangile développe ainsi : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Il ajoute : « Dieu a fait toutes choses par lui. » Or si on admet que tout, nous, les mondes et les univers, tout est un sans qu’il y ait de temps, ce silence et cette puissance du verbe sont les mêmes aujourd’hui et au commencement. Les implications de cette évidence sont colossales et merveilleuses pour notre monde déchiré. Nous avons vu que notre parole et notre silence habituels peuvent déjà être puissants, alors qu’ils sont passagers. S’ils appartiennent à ce qui demeure, quels seront leur pouvoir ?